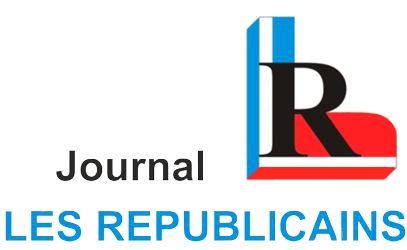Par Paul Vallet – historien et politologue franco-américain, résident à Genève où il est Associate Fellow du Geneva Center for Security Policy. Diplômé de, et a enseigné à Sciences Po Paris, la Fletcher School of law and diplomacy de Tufts University. Il a reçu son doctorat en histoire de l’Université de Cambridge.
[Il y a bien entendu une littérature américaine et anglaise considérable sur la Guerre d’Indépendance, ses origines, son déroulement et ses grands protagonistes. Pour les titres en français, il existe le tout récent ouvrage de Pascal Cyr et Sophie Muffat, La guerre d’indépendance américaine, Passés Composés, 2022. Cet ouvrage est particulièrement intéressant pour décrypter les origines économiques, fiscales et politiques du conflit.]
Au Massachussetts, cette fin de semaine est fériée, connue sous le nom de Patriots’ Day, et c’est traditionnellement lors de ce weekend qu’est couru le marathon de Boston. Or cet évènement local a une dimension nationale, puisqu’il marque les 18 et 19 avril 1775 où éclatèrent les premiers combats entre les troupes britanniques et les colons « américains » du Massachusetts qui allaient devenir les «Insurgés » de la Guerre d’Indépendance. La date est également fériée dans les autres Etats de Nouvelle-Angleterre mais ne l’est pas ailleurs dans l’Union. Il est piquant d’ailleurs de considérer cette appropriation locale puissante d’un évènement fondateur, comme si la Prise de la Bastille n’était commémorée qu’à Paris, voire dans le seul arrondissement où s’élevait autrefois la forteresse royale.
C’est dire, en fait, comment les hasards historiques peuvent marquer certains faits dans les vies des nations, et notamment à l’échelle d’un pays déjà vaste à l’époque et encore plus étendu depuis. Il est intéressant aussi de remarquer que ce conflit, que les Américains appellent plus communément « The Revolutionary War » pour souligner que son objectif politique allait bien au-delà de la lutte pour l’indépendance de colonies ultramarines de la couronne britannique, a justement éclaté par une succession d’incidents à portée de plus en plus grave. On est en présence, ici, d’un basculement dans la guerre par une suite de faits, qui diffère de certains autres conflits de l’histoire américaine que l’on identifie par des actes d’agression plus ou moins sérieux : par exemple, le bombardement du Fort Sumter en 1861 par les sécessionnistes de Caroline du Sud ; ou le raid aérien japonais sur Pearl Harbor en 1941 ; ou encore les attentats du 11 septembre 2001.
168 ans après le premier établissement de colons anglais sur la côte nord-américaine, les descendants de ceux-ci se trouvèrent projetés dans un combat qu’une génération plus tôt on aurait encore jugé très improbable. C’était pourtant la présence d’un océan, prenant huit à neuf semaines de traversée, qui séparait les colons de leur métropole européenne, et cet océan comme le passage du temps et l’expansion déjà prodigieuse de la population expatriée qui avait créé un fossé impossible à combler, une divergence que les armes seules allaient régler, au terme d’un conflit poursuivi âprement huit ans durant.
L’ironie est aussi que ce conflit soit né d’un traité signé à Paris, et qu’il allait se conclure aussi par un traité signé à Paris, à exactement vingt années de distance.
I. Germes de conflit
Les guerres comme les révolutions sont souvent comprises comme émanant de causes longues et de causes immédiates. Dans le cas américain, ces guerres fondatrices que furent aussi bien celle de l’Indépendance (1775-1783) que celle de Sécession (1861-1865) sont assez remarquable par la longueur temporelle de leurs origines, avec des causes que l’on va rechercher bien avant, et contrastant en cela avec les conflits plus modernes dont les causes sont plus immédiates, ce qui n’est pas sans incidence sur la signification de ces conflits pour l’histoire américaine. Ainsi, la Sécession peut-elle trouver son origine essentielle dès l’indépendance et l’adoption de la constitution américaine, pour n’avoir pas tranché la question si politique de l’esclavage. Alexis de Tocqueville identifiait, dès son voyage des années 1830, la question noire comme ferment d’un conflit national dangereux, soit encore une génération avant qu’il n’éclate effectivement. La Guerre d’Indépendance n’est pas supposée dès les premières décennies du XVIIème siècle, lors que les colons anglais s’établirent d’abord en Virginie en 1607, puis au Massachusetts en 1620. Cela dit, les deux premières colonies anglaises d’Amérique du Nord sont connues pour leur origine diverse. La Virginie avait été fondée comme un projet commercial, sous patronage royal, où les colons, et surtout les investisseurs qui ont soutenu leur émigration, comptaient bien tirer de mirifiques richesses. Au Massachusetts, la question était différente, car les colons qui s’y rendirent, les Puritains, étaient des dissidents religieux du protestantisme et de l’Eglise établie, recherchant une existence autonome. Venus sur le Mayflower, ils ont d’ailleurs abordé au Massachusetts et non en Virginie comme prévu au départ pour cause de vents contraires.
Voici d’ailleurs un motif intéressant pour le long terme : ces Anglais transplantés souhaitaient certes un cadre de vie sur lequel la norme religieuse, appuyée par l’autorité étatique, pèserait moins sur eux, mais ils ne songeaient pas à une rupture civilisationnelle d’avec leur pays d’origine. Les Puritains avaient déjà émigré pour certains aux Pays-Bas, mais beaucoup n’avaient pas apprécié l’acculturation de se trouver en pays de langue flamande. Au Massachusetts, ils iraient donc fonder villes et comtés auxquels ils donneraient naturellement les noms des régions anglaises dont ils étaient issus, pour l’essentiel, l’est de l’Angleterre, où l’on trouve les Boston et Cambridge d’origine. Les Puritains de ces régions restés en Angleterre jouèrent d’ailleurs un rôle important dans la première révolution anglaise et la guerre civile qui éclatèrent en 1641, exactement vingt ans après le voyage du Mayflower. Là déjà, il s’agissait d’une opposition à une tendance jugée absolutiste de l’autorité royale, à la défense de la prérogative du Parlement qui incarnait les privilèges politiques de l’oligarchie bourgeoise et aristocratique.
Il faut d’ailleurs relever que cet esprit puritain était, dans le cas anglais comme dans le cas américain, suffisamment rigide pour appuyer avec virulence des causes défendues contre les adversaires. Le Massachusetts fut même perçu, en particulier autour des années 1690 avec l’affaire des chasses aux sorcières de Salem, comme une incarnation de l’intolérance. D’autres colonies fondées dans les années suivantes se voulurent justement plus diverses dans leurs compositions religieuses et ethniques. Le petit Rhode Island voisin érigea même cette tolérance religieuse au rang de valeur principale. La colonie de New York intégra de nombreuses personnes d’ascendance hollandaise et scandinave, alors que la Pennsylvanie vit aussi l’arrivée de nombreux colons fuyant les terres allemandes ravagées par la Guerre de Trente Ans. Les colonies du Sud, les Carolines et la Géorgie, accueillirent des huguenots français après la Révocation de l’Edit de Nantes comme des populations déportées par répression d’Ecosse et d’Irlande à la suite de la seconde révolution britannique et des soulèvements jacobites.
Ces colonies qui atteignirent le mythique chiffre de treize dans la première moitié du XVIIIème siècle montrèrent d’abord leur vigueur par leur expansion démographique, comme leur économie au potentiel puissant, notamment grâce à l’agriculture. On observait que la natalité y était même supérieure à la moyenne européenne, ce qui fit largement gonfler ces populations comparée aux faibles communautés d’origine française dans le bassin du Saint-Laurent puis celui du Mississippi, vivant en plus forte proximité des nations indiennes, ou des petites communautés hispaniques de Floride et de la côte du Golfe du Mexique. Ces colonies constituèrent donc un adversaire puissant aux velléités, pas toujours conséquentes, de la France de créer sa propre grande colonie nord-américaine. Quatre conflits nord-américains, transposant les affrontements européens des métropoles anglaise et française, rythmèrent la fin du XVIIème et la première moitié du XVIIIème siècles.
Le dernier fut le conflit décisif, baptisé Guerre de Sept Ans en Europe et connu sous le nom de « French and Indian War » en Amérique. C’est celui qui vit la conquête du Canada par un effort militaire britannique naval et terrestre très déterminé, et appuyant la volonté des colonies de se défaire de leurs rivaux au nord et à l’ouest. De façon stratégique, les Britanniques s’appuyèrent aussi en prenant comme alliés indiens la confédération iroquoise, contre les tribus algonquines alliées des Français. Les prises de Louisbourg, Québec puis Montréal convainquirent Louis XV et ses ministres de renoncer, pour conserver les plus riches îles des Antilles, au premier traité de Paris, donc, en 1763.
II. Du litige fiscal et commercial à la discorde politique
Le conflit s’était d’ailleurs avéré ruineux pour les deux parties, mais en particulier pour le vainqueur, car si le premier ministre William Pitt l’Ainé avait fixé avec détermination des objectifs de conquête de toute l’Amérique du Nord, celle-ci imposa à la fois la suprématie maritime de la Royal Navy mais aussi un effort important des forces terrestres, en particulier de l’armée régulière, les fameux Redcoats ou Regulars, car les colons ne fournissaient que des milices plus aptes au combat d’escarmouche local qu’à la grande stratégie manœuvrière que supposait l’invasion du Canada. Rarement la Grande Bretagne s’était retrouvée, en dépit de sa révolution industrielle naissante, dans une situation où ses recettes ne pouvaient combler une si importante dette.
L’arme fiscale fut donc dégainée en direction de ceux que Londres estimait comme les principaux bénéficiaires de la guerre, ses colons américains. La décision survenait aussi dans un contexte particulier qui faisait que la guerre terminée par un traité européen n’effaçait pas un risque sécuritaire aux Amériques, où les Britanniques devraient conserver d’importantes troupes. La révolte des Nations indiennes autour du chef outaouais Pontiac fut jugée suffisamment dangereuse que pour obtenir le retour au calme, les autorités britanniques décidèrent aussi de barrer l’accès de leurs colons aux territoires nouvellement conquis de l’Ouest jusqu’au Mississippi pour le réserver aux Indiens.
C’est étonnant de constater que les dirigeants britanniques, qui venaient de consacrer toute leur attention à la victoire finale sur l’ennemi français en Amérique, ne comprenaient pas les affaires américaines. On le voit notamment dans le personnage du futur principal protagoniste militaire britannique de la bataille de Lexington et Concord, le général Thomas Gage. Âgé de 54 ans en 1775, celui qui était commandant-en-chef pour l’Amérique du Nord et également gouverneur-militaire du Massachusetts habitait là depuis vingt ans, et avait épousé une héritière du New Jersey, Margaret Kemble. Second fils d’un vicomte, Gage était militaire depuis 1736, avait combattu à Fontenoy et à Culloden avant d’être envoyé en Amérique dès le début des hostilités contre la France en 1755, ce qui l’avait amené à côtoyer un lieutenant de milice virginien, George Washington. En tacticien militaire partisan des formations d’infanterie légère, et adepte d’une guerre adaptée au terrain américain, Gage participa à la conquête du Canada et fut le premier gouverneur britannique de Montréal, avant de prendre le commandement-en-chef au moment de la révolte de Pontiac, qu’il s’attacha à résoudre par la négociation plutôt que la pression militaire.
Etablissant son quartier général à New York, dont la population de 25000 dépassait les 16000 de Boston, pourtant ville plus ancienne, Gage fut bien placé pour observer la dégradation rapide des relations entre les colonies et Londres. L’une des raisons pour lesquelles il n’avait pas voulu engager de grande expédition à l’Ouest contre Pontiac et ses alliés fut la nécessité pour lui de réserver d’importants corps de troupe, encore présents en Amérique une année après la signature du traité de Paris, pour les stationner dans les grandes villes des colonies.
Les villes américaines étaient le premier théâtre des réactions outrées de certains milieux contre les décisions prises par le gouvernement à Londres immédiatement à la fin de la guerre pour renflouer les caisses : accroitre les recettes fiscales en provenance des colonies. Vu de l’Echiquier, qui fut le principal département gouvernemental britannique en responsabilité dans l’affaire, on pouvait facilement accroitre les revenus en faisant appliquer des dispositions légales existantes, mais inégalement mises en œuvre dans les colonies. En premier, par la taxation de produits à la vente, procédé connu en France notamment par la fameuse gabelle sur le sel, et les aides sur le vin. Impôts d’ailleurs très impopulaires et toujours incitatifs à la pratique de la contrebande, ce qui se vérifia aussi en Amérique.
Le Parlement de Londres adopta d’abord le Sugar Act, qui taxait les importations en Amérique du Nord de sucre et mélasse des Caraïbes. Or, ces produits considérés comme un luxe en Angleterre étaient devenus produits de consommation courante dans les colonies, servant aussi à la transformation et conservation de nombreux produits. La nouvelle taxe frappa donc durement tous les segments de la population. Le Currency Act, qui suivit, et avait pour but de renforcer les contrôles d’émission et le monopole monétaire des Britanniques, eut aussi des répercussions plus larges que prévues sur les Américains. Le Stamp Act, la plus célèbre de ces lois fiscales britanniques, en renchérissant le droit de timbre officiel sur tous les actes mais aussi tous les imprimés, provoqua les protestations les plus furieuses. Enfin, le Quartering Act préoccupa plus directement le général Gage, puisqu’il exigeait un effort en nature des Américains en leur imposant de loger chez eux les soldats des forces de Sa Majesté chargées de les surveiller.
Les autorités britanniques ont ainsi constaté dès 1764 que non seulement les coloniaux étaient récalcitrants aux nouvelles mesures, mais qu’ils l’étaient suffisamment pour que des désordres nécessitent une première réponse militaire de maintien de l’ordre. Ce grief s’ajouta aux autres ressentis par les Américains, qui voulaient que la couronne leur ouvre l’accès à l’Ouest, interdit pour se concilier les nations indiennes après la révolte de Pontiac, et que le corps expéditionnaire britannique reparte pour ne plus avoir à en supporter les frais.
Plusieurs polémistes américains entrèrent dans le jeu par leurs écrits de résistance aux lois britanniques. De façon intéressante, ce fut à Boston, plus petite que Philadelphie et New York, qu’émergèrent les voix les plus retentissantes, parmi lesquelles le brasseur Samuel Adams et James Otis, procureur de la cour d’amirauté. Boston, comme les autres villes portuaires de Nouvelle-Angleterre, était tout particulièrement grevée par les taxes sur le sucre et la mélasse. Ce furent Adams et Otis qui eurent l’idée de réfuter l’autorité du Parlement de Londres pour légiférer dans ces domaines en arguant que les colonies n’y envoyaient pas de députés. « No Taxation Without Representation » était un slogan d’autant plus puissant qu’il prétendait s’inspirer de la raison d’être du parlementarisme britannique depuis la Charte de 1215 et bien entendu des révolutions du XVIIème siècle. Les colonies possédaient d’ailleurs depuis longtemps leurs propres assemblées, tout aussi censitaires et oligarchiques que celles de Londres, et ces dernières se mirent aussi à contester les décisions anglaises comme celles des gouverneurs royaux.
La venue des forces de Gage dans les villes ne calma pas les troubles et dès l’été 1765, la demeure bostonienne du gouverneur Thomas Hutchinson fut mise à sac par une foule déchainée, d’autant que les imprimeurs, visés par le Stamp Act, se vengèrent en diffusant de plus en plus de littérature et tracts révolutionnaires. À l’automne 1765 neuf colonies sur treize adressèrent une pétition à Londres, exigeant leur représentation au Parlement, alors qu’un mouvement de boycott des produits britanniques était engagé dans les grandes villes. Si le gouvernement britannique, dont deux premiers ministres avaient chuté sur ces tensions avec les colonies, consentit à abroger le Stamp Act, ce fut pour les remplacer par des mesures douanières plus sévères. Le renforcement des contrôles douaniers signifiait un renforcement de la présence de la Royal Navy dans les eaux américaines en plus de la présence des soldats dans les ports. De bien nommés « Restraining Acts » furent votés à l’encontre des faiseurs de troubles tant à New York qu’à Boston.
La cohabitation entre militaires britanniques et colons s’avéra encore plus problématique à partir de 1768 et l’arrivée de renforts importants en garnison à Boston. Les soldats ayant pour habitude d’augmenter leur solde en louant leurs services concurrencèrent nombre d’artisans et d’ouvriers de la ville, et les litiges pour factures impayées se multiplièrent. On y voit l’origine de la fusillade qui éclata un froid soir de mars 1770 lorsqu’une foule en colère prit à partie les sentinelles devant l’hôtel des douanes. Paul Revere, un jeune orfèvre dont la famille était d’origine huguenote, fit paraitre une gravure illustrant cet incident sous le nom de « Massacre de Boston », très largement distribuée et imputant la tuerie à la cruauté des soldats britanniques. Ces derniers furent soumis à un procès et trouvèrent un étonnant défenseur en John Adams, cousin de Samuel, qui parvint à les faire acquitter en démontrant effectivement que les soldats avaient été provoqués. Cependant, l’avocat américain fit aussi remarquer avec éloquence que la responsabilité des troubles remontait au gouvernement de Londres.
Les incidents à Boston n’allaient qu’augmenter alors que les navires britanniques tentaient de plus en plus inefficacement d’intercepter les vaisseaux de contrebande, avec la poursuite des boycotts de produits britanniques. La décision de Londres d’imposer un monopole de vente du thé par l’East India Company, qui se trouvait en grave situation financière, provoquèrent un nouveau passage à l’acte de militants américains, la « Boston Tea Party », où les cargaisons de trois navires furent jetées à la mer plutôt que débarquées. Ce dernier évènement détermina Londres à faire fermer le port de Boston, à y envoyer des renforts et à nommer Gage gouverneur militaire du Massachusetts, appliquant la loi martiale avec 10000 soldats et plusieurs vaisseaux de ligne de la Royal Navy.
III. Un raid préventif pour éviter un siège
Le général Gage semblait déjà convaincu de la précarité de la situation, en relevant le gouverneur Hutchinson en février 1774, en estimant qu’ils étaient à un tournant pour savoir si l’on continuerait à avoir des colonies ou « des Etats séparés ». Son expérience passée lui faisait bien sentir qu’il se trouvait, avec ses régiments, en territoire ennemi, et il ne cessa de demander des renforts terrestres et navals. Il disposait de treize régiments d’infanterie, dont les formations légères qu’il prisait, mais de peu de cavalerie pour effectuer les patrouilles de reconnaissance. Les seuls autres renforts qu’il reçut furent le 1er bataillon de Marines.
Face à Gage, les habitants du Massachusetts n’étaient pas juste organisés en sociétés secrètes et avaient formé des « comités de correspondance » chargés non seulement de la surveillance des faits et gestes des autorités britanniques, mais qui étaient aussi les producteurs et diffuseurs des idées révolutionnaires. La colonie s’était aussi dotée d’un comité provincial se considérant comme un véritable contre-gouvernement opposé à la loi martiale. C’était aussi ce comité qui envoyait ses délégués, parmi les plus radicaux du pays, au premier « congrès continental » réuni à Philadelphie dès l’automne 1774, appelant à la résistance économique et politique dans douze des treize colonies représentées.
Surtout, le cauchemar de Gage étaient les milices dont la Nouvelle-Angleterre était abondamment pourvue. Depuis Concord, à l’intérieur des terres, un « comité de sureté » composé des radicaux John Hancock, Joseph Warren et Benjamin Church, qui dominait politiquement en l’absence à Philadelphie des deux Adams, avait ordonné la constitution d’arsenaux militaires, et avait appelé à pouvoir équiper 20000 hommes, le double de ce dont disposait Gage, en réunissant les milices du Connecticut, du Rhode Island et du New Hampshire. En tant que colonies frontalières de l’ancienne Nouvelle-France, ces dernières avaient participé au dernier conflit et comptaient encore de nombreux cadres d’expérience. Chaque commune était requise de par la loi d’entretenir une milice où presque tous les hommes étaient appelés dès leurs 16 ans. Le comité avait aussi efficacement levé des fonds pour acheter, outre les fusils et les pistolets et leurs munitions, vingt pièces d’artillerie. Gage n’avait que peu de pièces de campagne, mais pouvait compter sur l’artillerie de ses navires dans le port.
La configuration de Boston en 1775 était d’ailleurs très différente de celle d’aujourd’hui. On a vu que la ville ne comptait alors de 16000 habitants, mais un nombre bien plus important résidaient dans la foule de localités l’entourant au nord, à l’ouest et au sud. Boston était alors située sur une presqu’ile, reliée au continent par un très étroit goulet, le Boston Neck. Les embouchures des rivières Charles et Mystic à l’ouest et au nord en se jetant ensemble dans la rade isolaient bien la ville et compliquaient les déplacements, donnant au port une activité intense de transit. La limite de Boston, avant le Neck, se trouvait à l’emplacement actuel des Commons, le terrain de pâturage devenu parc public de nos jours. Il fallait suivre une route passant le Neck entre les marais, par Roxbury puis Brookline, pour aboutir à un point où la Charles se rétrécissait assez pour être franchie par un pont permettant d’accéder à Cambridge et poursuivre vers l’ouest ou le nord de la province.
Dès l’été 1774, le général Gage avait dû se résoudre à la situation de se trouver littéralement enfermé dans Boston, certes pouvant obtenir un soutien par la mer, mais l’autorité royale n’était déjà plus guère assurée hors de la ville-presqu’île, alors même qu’il y avait encore quelques Loyalistes dans la province, mais bien isolés par rapport à l’autorité des révolutionnaires. Gage pouvait même craindre de se retrouver assiégé par des forces conséquentes si les Américains menaient à bien le projet de réunir les forces des milices de toute la Nouvelle-Angleterre et peut-être même venant des autres colonies, principalement New York, la Pennsylvanie et la Virginie où l’on trouvait les plus fervents partisans d’un soutien aux « patriotes » du Massachusetts. Gage savait en outre se trouver dans une ville dont une bonne partie de la population lui était déjà hostile, et informait le comité de sureté à Concord des mouvements des forces britanniques, dans Boston même et au dehors. Le général devint obsédé aussi bien par la préservation de la sécurité de ses troupes que par la sauvegarde du secret de sa correspondance. Sa propre épouse Margaret était soupçonnée de sympathies pour les révolutionnaires.
Dans l’attente de ces renforts tardant à venir, car ce serait en février 1775 que les deux chambres du Parlement enverraient une adresse au roi George III pour déclarer « l’état de rébellion » dans les colonies, le général Gage cherchait à agir préventivement pour affaiblir ses adversaires futurs, tout en évitant une confrontation armée irréparable. Si les hommes des milices des autres provinces tardaient à arriver, il y avait bien des rapports de concentration de provisions, de poudre, balles et mousquets dans des poudrières communes établies depuis les premiers temps de la colonie. Le 1er juin 1774, Gage lança une colonne de son 4ème Régiment le long de la Mystic River pour saisir un arsenal à Winter Hill, à seulement deux kilomètres au nord de Boston. La rapidité de mouvement des soldats britanniques surprit les miliciens, qui décidèrent ensuite de s’organiser pour disperser leurs entrepôts, et surtout veiller au déclenchement de nouveaux raids. Ces incidents se reproduisant fréquemment durant l’automne furent appelés des « Powder alarms », alertes à la poudre, et accrurent la psychose de guerre que Gage voulait décroitre.
Début 1775, la nouvelle que des pièces de canon étaient rassemblées près de Concord inquiétèrent le commandant des forces britanniques, qui sentait que sa liberté d’opérer hors de l’enceinte de Boston serait bientôt compromise. Les « Powder alarms » successive avait d’ailleurs amélioré le système d’alerte provincial, chaque mouvement britannique étant signalé par les tambours ou les cloches appelant les miliciens aux armes. Les provinciaux eux-mêmes avaient convaincu d’établir au sein des milices un corps d’hommes immédiatement disponibles portant le nom éloquent de « Minutemen ». Considérant que ces simples citoyens étaient avant tout des paysans des environs, ce nouveau corps marquait un nouveau degré insoupçonné de discipline et d’entrainement parmi les miliciens et leurs officiers qui ne pouvait qu’être préoccupant pour Gage.
Le 14 avril, Gage reçut un ordre formel de Lord Dartmouth, secrétaire d’Etat à Londres, qu’il lui fallait agir pour désarmer les milices et arrêter des dirigeants rebelles, un ordre que Gage attendait en raison des démarches entreprises par les provinciaux pour réunir leurs unités. Il conçut le plan d’un raid de ses forces sortant de Boston pour aller à Concord se saisir des fameux vingt canons et en même temps de John Hancock et Samuel Adams, réputés s’y trouver d’après ce que lui avaient rapporté ses quelques éclaireurs à cheval. En revanche Gage se trompait sur la localisation de l’arsenal, qui se trouvait bien plus à l’ouest, à Worcester, Concord étant justement jugée trop proche de Boston pour être un emplacement sûr pour les précieux armements. Une reconnaissance effectuée par les soldats britanniques le 30 mars en direction de Watertown, en amont de la Charles et au sud-est de Concord, avait fait supposer aux habitants que les forces de Gage marcheraient bientôt sur Concord. L’alerte générale ne serait déclenchée que si l’on observait plus de 500 soldats sortant de Boston.
Gage, se sachant observé, imagina rechercher la surprise en faisant marcher ses hommes de nuit. Sa crainte que ses ordres ne soient diffusés trop tôt et soulève la curiosité des Bostoniens voyant les Tuniques Rouges s’équiper le conduisit à mettre ses ordres sous scellé, à n’être ouverts qu’à la dernière minute. Il chargea le lieutenant-colonel Francis Smith du 10ème Régiment de commander l’expédition, mais lui précisa, l’après-midi du 18 avril, de n’ouvrir le pli d’ordres cacheté qu’une fois que ses troupes seraient en route. Le major écossais John Pitcain, des Marines, serait son commandant en second. Une force de réserve, encore plus considérable que celle chargée du raid, serait constituée à Boston et prête à sortir sous le commandement du général de brigade Comte Percy, héritier du duc de Northumberland et colonel du 5ème Régiment. Comme à son habitude, Gage divisait ses forces en choisissant les compagnies légères et de grenadiers de onze sur treize de ses régiments pour marcher sur Concord, et mettant leurs compagnies lourdes en réserve, pourvues aussi de deux canons de 6 livres.
Pourtant, en soirée, les préparatifs britanniques furent aisément constatés des habitants de la ville. Traversant le Boston Common, d’où embarquaient les soldats, Percy fut consterné de s’entendre dire par un passant civil que « les soldats vont manquer leur cible à Concord ». Le temps que Percy ne retourne prévenir Gage ne permit pas de bloquer tous les départs de la ville. À Boston se trouvaient encore cachés Paul Revere et Joseph Warren ainsi qu’un nombre d’autres militants chargés de donner l’alarme. Revere avait requis le pasteur de la North Church d’aller poster des lanternes dans son clocher pour indiquer à d’autres observateurs de l’autre côté de la Charles l’itinéraire emprunté par les troupes britanniques. Voyant que les marins commençaient à convoyer les soldats à travers la Charles pour prendre le chemin le plus court, le pasteur donna le signal au moyen de deux lanternes. Revere, au moyen d’un canot, passa sous les canons de la frégate HMS Somerset ancrée dans la rade et se fit débarquer à Charlestown d’où il partit à cheval le long de la Mystic criant « The Regulars are out ! » pour alerter les villages de l’intérieur, rejoint en route par un autre messager sorti par le Neck, William Dawes.
Pour rajouter aux déconvenues de Gage, le colonel Smith prit du temps à rejoindre ses troupes à travers la Charles, vers deux heures du matin le 19 avril. Les soldats étaient trempés d’avoir débarqué des barges dans l’eau jusqu’à la taille et dans la confusion par manque d’organisation de la part des officiers. Un certain nombre de compagnies, qui possédaient leurs propres lieutenants, s’étaient vues placées sous les ordres temporaires de capitaines venus d’autres unités mais tenant à acquérir un titre de gloire en participant à l’expédition. Après que les hommes aient mangé leur ration, Smith mit ses colonnes de 700 hommes en route et ouvrit ses ordres, qui devaient le conduire à Concord, distante de 27 kilomètres. Grâce à Revere et ses complices, en revanche, les localités à 40 kilomètres autour de Boston étaient déjà prévenues de sa marche, et appelaient leurs Minutemen à se rassembler, puis converger. Revere et Dawes avaient déjà atteint, puis quitté, Lexington alors que Smith se trouvait encore au bord de la Charles. Après avoir traversé Cambridge et le campus du Harvard College, les Britanniques avancèrent dans Menotomy, aujourd’hui Arlington. Les roulements de tambours et les cloches de village sonnant le tocsin avertirent Smith que son opération ne bénéficiait plus de l’effet de surprise. Vers 3 heures du matin, il ordonna au Major Pitcairn d’emmener les six compagnies d’infanterie légère et Marines en avant-garde à toute vitesse sur Concord. À 4 heures, Smith renvoya un messager à cheval prévenir le général Gage de faire intervenir la force de réserve.
Le souci du secret revint ajouter à la désorganisation des officiers de Gage. Les ordres de marche pour la colonne de réserve avaient eux aussi été laissés scellés sur les bureaux de plusieurs officiers, dont certains comme le major Pitcairn étaient en fait déjà en marche avec la force de raid… Personne ne se trouvait à leur place pour les ouvrir lorsque Gage le requit. La brigade du général Percy ne quitta pas Boston, par la route du Neck, avant neuf heures du matin, et qu’on se battait déjà à Lexington.
IV. Du sang sur le green
Atteignant Lexington, Revere et ses compagnons y avaient retrouvé John Hancock et Samuel Adams, qui convinrent que la taille de l’expédition britannique signifiait que c’était Concord qui était visée. Tous décidèrent de s’éparpiller pour prévenir les autres localités. Samuel Prescott se joignit à Revere et Dawes pour se rendre à Concord, mais peu avant l’aube dans le village de Lincoln, ils se trouvèrent interceptés par la patrouille à cheval du 5ème Régiment qui recherchait Adams et Hancock depuis plusieurs jours. Revere arrêté, Dawes s’enfuit à pied, mais Prescott put rejoindre et alerter Concord et les villages au-delà. Avant la fin de la journée près de 4000 miliciens de tout l’est du Massachusetts avaient été appelés, soit le double des forces engagées par les Britanniques.
À Lexington, il y avait 80 miliciens qui attendirent presque toute la nuit l’arrivée des Britanniques, rassemblés dans une taverne au bord du pâturage central du village, dit « common » ou « green », tandis qu’une partie non négligeable des habitants réveillés par l’alerte observaient ce qui se passait depuis le bord de la route. La compagnie était un groupe d’hommes à l’entrainement sous le commandement de leur capitaine, John Parker, qui avait combattu pendant la Guerre de Sept Ans. Un certain nombre des hommes n’étaient pas seulement ses voisins mais aussi des parents. Parker n’avait pas reçu d’ordres précis hormis d’assembler sa compagnie. Il savait en revanche que les provisions de Concord avaient déjà été dispersées et pensait que les Britanniques en seraient quittes pour une marche dans la campagne sans rien trouver. Il aurait sans doute renvoyé ses hommes si les compagnies légères de Pitcairn n’étaient déjà arrivées à Lexington. Voulant sans doute envoyer aux Britanniques un message de détermination, il mit en ligne ses hommes « en parade » sur le pâturage en leur recommandant de ne pas tirer si on ne leur tirait pas dessus.
La première des compagnies britanniques arrivant sur place appartenait au 4ème Régiment, commandée par le lieutenant des Marines Jesse Adair, suivie d’autres unités du 10ème, qu’accompagnait le major Pitcairn, et d’autres parmi lesquels des engagés gallois du 23rd Royal Welsh Fusiliers et des Irlandais du 18th Royal Irish. La position tenue par les miliciens de Parker ne bloquait pas la route de Concord, que Pitcairn avait ordre de rejoindre à toute allure, et les deux forces auraient pu ne pas se voir, ou même s’affronter. Le lieutenant Adair, en revanche, apercevant la ligne de miliciens, voulut constituer un flanc-garde pour la colonne principale avançant sur la route et fit exécuter un quart de tour à droite pour ranger sa ligne face aux hommes de Lexington. Pitcairn arrivait avec ses compagnies sur leur gauche, et Parker se rendit compte qu’il serait encerclé. L’infanterie britannique adopta la formation d’usage sur trois lignes permettant de lâcher trois volées rapides et de recharger avant une attaque à la baïonnette.
La tradition veut que ce soit le major Pitcairn, qui en raison de son rang était monté sur un cheval, qui ait lancé les sommations à la milice de Lexington. Il leur ordonna d’abord de se disperser, puis en rajouta en leur criant : « Jetez vos armes, vous vilains rebelles ! »
Parker, en ordonnant à ses hommes de ne pas tirer, avait ajouté « if they mean to have a war, let it begin here. » (« S’ils ont l’intention d’avoir une guerre, laissons-la commencer ici »). À présent, constatant son infériorité numérique et n’ayant pas l’intention d’ouvrir les hostilités, pas plus qu’il ne voulait rendre les armes, il ordonna à la milice de se disperser et de rentrer dans leurs maisons. Il semble en revanche que dans le tintamarre ambiant, l’ordre n’ait pas été entendu ou mal parce que Parker avait une voix affaiblie par la tuberculose. Il semble que les tirs ont commencé alors que la ligne des Lexingtoniens commençait à se défaire.
Dans la légende américaine, on parle du premier coup de feu tiré à Lexington comme du « shot heard around the world ». Comme dans les suites du « massacre de Boston » cinq ans plus tôt, il y a eu des efforts que les nombreux témoins survivants n’ont pas corroboré pour insinuer que c’étaient les soldats britanniques qui avaient « tiré les premiers », mais pas dans un geste de courtoisie convenue comme à Fontenoy. Certains ont assuré qu’un des pistolets que portait Pitcairn s’était déchargé pendant qu’il criait ses sommations. Le fait est que Pitcairn avait aussi recommandé à ses hommes, comme Parker, de ne pas tirer, et le mystère reste entier. Les témoins britanniques et américains ont pour beaucoup estimé que le coup de feu n’est pas provenu de ceux qui se faisaient face sur le pré mais des alentours. Lors du début de la fusillade, certains étaient même persuadés que les fusils tiraient à blanc, par intimidation, et furent surpris de recevoir des balles.
Déjà en formation, les Regulars tirèrent leurs volées puis chargèrent baïonnette au canon pendant que les miliciens qui n’étaient pas tombés blessés ou tués s’enfuyaient déjà. D’après le lieutenant britannique Barker, les Américains ne tirèrent qu’un ou deux coups en retour, et seul un fantassin du 10ème Régiment fut blessé. En face il y eut huit morts, dont le cousin du capitaine Parker, Jonas, tué à coup de baïonnette, et dix blessés. Le combat se déroulait si près des maisons que l’un des miliciens mortellement blessé, Jonathon Harrington, se traina jusqu’à son propre seuil pour y mourir sous les yeux de son épouse. La grande majorité de la compagnie s’échappa, et Pitcairn et ses subordonnés eurent fort à faire pour rappeler les soldats voulant les poursuivre ou fouiller les maisons, parce qu’ils devaient reprendre sans tarder leur route vers Concord. Arrivé sur les lieux avec la force principale, ce fut le colonel Smith qui fit battre le rappel.
On constate avec intérêt que Lexington n’est pas à proprement parler une « bataille », mais une fusillade qui s’est conclue en quelques instants. L’incident aurait très bien pu ne pas éclater, et survint d’un certain nombre de circonstances hasardeuses. On a vu que Parker aurait pu décider de ne pas aligner ses hommes sur le pré et se contenter d’observer le passage des Britanniques en embuscade. La colonne britannique elle-même aurait pu poursuivre sa progression en ignorant la petite troupe en armes qui n’était pas en position de tir. Il y avait en revanche un grand état de nervosité chez des hommes qui de part et d’autre avaient passé la nuit sous les armes : les Américains veillant et attendant, les Britanniques en marche, pour une mission dont les hommes du rang n’avaient aucune idée, et sous les ordres d’officiers qu’ils ne connaissaient pas. Ils subissaient depuis de longs mois, dans les rues de Boston même, les injures de la population, et craignaient manifestement une embuscade. Dans ces circonstances-là, la fusillade s’explique. Pour accidentelle qu’elle ait été, le nombre supérieur des tués américains allait persuader ces derniers qu’ils subissaient l’agression des forces de la couronne. Comme la sortie des troupes britanniques commandée par le général Gage, la nouvelle de l’affrontement et surtout des morts à Lexington se répandit extrêmement rapidement dans la campagne, et les milices bien plus nombreuses se rapprochaient de Concord.
V. La surprise gâchée à Concord
Quelque peu retardés par l’escarmouche inattendue de Lexington mais aussi par leur propre désorganisation, les troupes britanniques arrivèrent à Concord après presque sept heures de marche. La milice du village, assistée par celle de Lincoln, avait eu le temps de se rassembler, en nombre plus important qu’à Lexington, près de 250 hommes commandés par le colonel James Barrett. Ils s’étaient avancés sur la route jusqu’à entendre les coups de feu de Lexington. Désormais informé des évènements, Barrett choisit de replier ses forces face aux troupes britanniques supérieures en nombre, mais sachant bien que de très nombreux renforts lui accouraient depuis les villages avoisinants. Concord présente la particularité d’être au confluent de trois rivières, la Concord, la Sudbury et l’Assabet, qui se trouvaient d’ailleurs gonflées par la fonte de printemps, nécessitant de prendre contrôle de ses ponts au nord et au sud pour tenir la localité, également entourée de nombreux bois et chemins creux. Révélant aussi un bon sens tactique, Barrett retira ses hommes sur une colline au-delà du North Bridge d’où il pouvait observer les Britanniques en restant hors de leur portée pendant qu’ils entraient dans son village. Il y reçut des renforts venus des villages à l’ouest et se trouva avec près de 400 Minutemen.
À Concord, le colonel Smith fut contraint de diviser ses forces assez largement, autant pour tenir les accès, notamment les deux ponts, et en envoyer d’autres fouiller les maisons et les alentours à la recherche vaine de Hancock, Adams, et autres membres du comité de sûreté, ainsi que les armes, les provisions, et notamment les fameux canons. Sans y prendre garde, et parce qu’il opérait avec des officiers intervertis d’entre leurs unités d’origine ne connaissant pas leurs soldats, Smith ne se rendit pas compte qu’il affaiblissait ses compagnies en les séparant pour diverses missions. Ainsi, il y avait mois d’une centaine d’hommes de compagnie légère du 43ème régiment pour tenir le North Bridge sous le commandement d’un capitaine Laurie qui n’était pas de chez eux. Commandées par le capitaine Parsons, quatre compagnies tirées des 4ème, 23ème, 38ème et 52ème traversèrent le pont pour aller fouiller une ferme, ironiquement appelée « Barrett’s Farm » où ils pensaient trouver des armes.
Du côté opposé de la ville, près du South Bridge, les troupes de Pitcairn fouillèrent une taverne et sous la menace d’une arme contraignirent le tavernier à leur révéler où étaient enfouis des canons. Ce n’étaient pas vingt pièces mais trois gros tubes, capables de tirer des boulets de 24 livres et davantage des armes de siège que de campagne. Pitcairn n’avait ni le moyen de les transporter, ni celui de les saboter, aussi fit il fracasser leurs tourillons pour qu’on ne puisse les monter sur des affuts. Dans la salle d’assemblée du village, d’autres soldats trouvèrent les châssis de ces canons et y mirent le feu, communiquant l’incendie au bâtiment. Sur ces entrefaites, une dame de Concord, Martha Moulton, se présenta et convainquit les soldats de faire la chaine avec des seaux pour éteindre le feu qu’ils avaient allumé… Des provisions de nourriture et des balles de mousquet furent également découvertes mais les Britanniques pressés se contentèrent de les jeter dans l’étang.
Apercevant qu’il y avait peu de soldats britanniques au North Bridge, le colonel Barrett choisit d’envoyer ses miliciens quatre fois plus nombreux pour les impressionner, fusils chargés mais maintenant l’ordre de ne pas tirer à moins qu’on ne leur tire dessus, comme Parker l’avait ordonné selon des instructions qui semblent avoir été largement partagées à tous les miliciens pendant la matinée. Les Britanniques gardant le pont furent effrayés par le nombre d’hommes armés avançant vers eux et se replièrent de l’autre côté. Au lieu de les aligner pour maximiser leur puissance de feu, leur capitaine Laurie les fit mettre en position dans l’axe du pont et perpendiculairement à la rivière, entravant leur ligne de tir. Un premier coup de feu partit des Britanniques sans ordre, suivi par d’autres qui tuèrent deux miliciens marchant en tête vers le pont.
À quoi répliqua l’adjoint du colonel Barrett, le major Buttrick ordonnant le feu à volonté « Fire, for God’s sake, fellow soldiers, fire ! ». Tirant par-dessus les épaules de leurs camarades, les Américains touchèrent la moitié des officiers et sous-officiers britanniques présent, tuèrent et blessèrent douze soldats. Pris de panique, les Regulars s’enfuirent vers Concord en abandonnant et leurs blessés et le North Bridge aux Américains, et oubliant les quatre compagnies parties à Barrett’s Farm. Barrett, justement, retira ses miliciens vers des positions sures de chaque côté de la rivière. En revenant à Concord, les troupes du capitaine Parsons découvrirent les tués et les blessés, y compris l’un d’eux dont ils pensèrent qu’il avait été scalpé, ce qui ajouta à leur panique.
Le colonel Smith, dont l’essentiel de la mission avait été accomplie, n’ayant trouvé que peu d’armes et aucun des révolutionnaires qu’il recherchait, ne voulait pas s’attarder, n’ayant pas une bonne idée du nombre de miliciens qui convergeaient sur lui, et d’autant plus nerveux avant d’avoir récupéré les compagnies de Parsons, ou encore les blessés abandonnés près du pont. Les deux forces s’observèrent à distance, mais ne s’engagèrent pas. Connaissant la longueur de la route à suivre pour le retour, Smith décida de replier toutes ses forces à partir de midi. Son départ fut le signal donné pour des attaques générales et répétées par les centaines d’autres miliciens accourus pour renforcer Barrett. Ils étaient désormais plus d’un millier et plus nombreux que les Regulars dont l’épuisement se faisait sentir.
Bien qu’il ait fait avancer une colonne de flanc sur sa gauche, gardant le nord de la route d’axe est-ouest qu’il empruntait, le colonel Smith fut embarrassé par l’enchevêtrement de rivières et ruisseaux bordés de bois autour de Concord qui le contraignait à resserrer ses flancs-gardes sur la route. Poursuivis par les miliciens de Concord harcelant leurs arrières, les Britanniques se trouvèrent tiraillés d’abord sur leur gauche, puis sur leur droite. Cela leur arriva quatre fois sur la route de Lexington, infligeant à chaque fois des pertes en tués et blessés, notamment au lieu-dit « Bloody Angle » ou une courbe de la route exposait les soldats à des tirs croisés. Sans cesse renforcés et désormais près de deux mille, les Minutemen tiraient au couvert des bois, maisons, murets et depuis les collines. À l’approche de Lexington, les hommes du capitaine Parker, y compris les blessés, s’étaient remis en position et menèrent la quatrième de ces embuscades. Le colonel Smith y prit une balle dans la cuisse et tomba de cheval, devant être relevé par Pitcairn.
VI. La retraite et le bilan : la guerre a bien commencé ici
En revenant à Lexington, il n’y avait plus qu’un seul officier britannique encore indemne parmi tous ceux qui avaient pris la route, parce que Pitcairn avait été blessé à son tour en étant désarçonné par son cheval effrayé par la fusillade. En chutant, il perdit ses pistolets métalliques dont les Américains, en les récupérant, allaient prétendre qu’ils avaient tiré le premier coup de feu à Lexington. Il était deux heures de l’après-midi et les Britanniques marchaient depuis douze heures, et les embuscades répétées leur avaient fait tirer presque toutes leurs munitions sans pouvoir repousser les assauts répétés et déterminés des miliciens. Les témoins britanniques le reconnaissaient, leurs troupes commençaient à fuir en courant le long de route, ne maintenant pas la formation. Ce fut à la sortie de Lexington qu’ils rencontrèrent la colonne de renfort de Lord Percy, qui avait fait mettre en batterie ses deux canons pour couvrir la retraite.
Comme on l’avait vu, Percy avait quitté Boston par la route faisant détour par le Neck et devant emprunter le pont de Cambridge, pendant que ses fifres et tambours jouaient une marche composée pour se moquer des Américains et devenue célèbre depuis, « Yankee Doodle ». En fait, des Américains avaient déjà commencé à retirer plusieurs planches du pont pour le saboter, ce qui marqua un premier retard. Arrivant ensuite à Cambridge, et faisant encore preuve de désorganisation, les Britanniques se trouvèrent à un embranchement de routes devant le campus de Harvard et ne surent quelle direction prendre pour aller à Lexington, au point de devoir demander leur chemin à un professeur du collège assez perplexe sur la tournure que prenaient les évènements. Les troupes de Percy étaient parties avec peu de munitions et un convoi de chariots devait les suivre pour leur en rapporter, mais ce dernier, escorté par treize hommes seulement, fut intercepté par des miliciens qui s’en saisirent.
À Lexington, Percy prit le commandement de toutes les troupes, relevant Smith et Pitcairn mis hors de combat par leurs blessures. Ses canons tirèrent des coups de semonce et les poursuivants restèrent à distance. Une pause d’une heure permit de soigner les blessés et de restaurer les soldats exténués. Percy fit adopter une formation profonde, les hommes de Smith au milieu, avec les blessés entassés sur les canons, et ses lignes de troupes gardant les flancs et les arrières, pratiquant une rotation des unités tous les deux kilomètres en progressant vers Boston.
Malgré cette tactique judicieuse de Percy, les miliciens désormais commandés par le général de brigade William Heath et Joseph Warren, arrivé de Boston, restaient déterminés à harceler la colonne tout le long de la route et à entraver sa progression autant que possible pendant que plusieurs milliers d’autres miliciens arrivaient désormais des provinces voisines. Avançant le long de la route avec la colonne britannique, les miliciens tiraillaient en embuscades incessantes alternant les côtés, par devant et derrière également. Le général Percy fut impressionné par l’organisation des Américains et leur exploitation habile du terrain pour harceler ses troupes, rapportant que « Ils ont des hommes parmi eux qui savent très bien ce qu’ils font, ayant été engagés comme Rangers contre les Indiens et les Canadiens, et ce pays qui est couvert de bois et de collines est très avantageux pour leur méthode de combat ».
Dans et autour de Menotomy, les attaques se produisirent depuis les maisons et leurs jardins, contraignant les Britanniques à les prendre d’assaut. Ce furent les combats les plus violents de la journée, avec quarante tués et quatre-vings blessés dans les rangs britanniques, surtout au 47ème Régiment et chez les Marines, contre 25 miliciens tués et neuf blessés. Dans ces combats sanglants il ne fut fait quasiment aucun prisonnier. Il y eut aussi des incendies et des pillages, particulièrement dans les tavernes, les hommes s’alcoolisant de part et d’autre pour se donner du courage. Poursuivant vers Cambridge et assailli par près de quatre mille hommes, Percy fut informé que le pont sur la Charles qu’il avait franchi ce matin même avait été démoli. Il choisit donc de bifurquer vers un autre chemin encore ouvert qui le ramènerait vers les hauteurs de Charlestown, d’où il pourrait être couvert par le feu des frégates de la Royal Navy. Arrivés là à la nuit tombée, ils furent renforcés d’autres compagnies par Gage et commencèrent à creuser des fortifications pour tenir en respect leurs poursuivants.
Par une ironie du sort, le général Gage ne voulut pas tenir ces points forts, et fit revenir toutes ses forces dans Boston. Les tranchées abandonnées furent occupées huit semaines plus tard par les Insurgés, déclenchant la bataille de Bunker Hill, où le major Pitcairn fut mortellement blessé en capturant la redoute qu’il avait commencé à édifier sur l’ordre du général Percy. Dès le 20 avril, en revanche, Boston se trouvait assiégée par 15000 Insurgés, qui seraient commandés par George Washington à partir du mois de juillet.
Les chefs révolutionnaires John Hancock et Samuel Adams, rejoints par John Adams qui parcourut à cheval les champs de bataille dès le lendemain pour observer de ses yeux ce qui s’était passé, repartirent au second congrès continental pour faire état auprès des autres colonies de l’agression dont ils jugeaient que le Massachusetts avait été la victime. Réveillé à Lexington, le premier réflexe de Hancock avait été de décrocher son fusil et de combattre avec la milice, mais on le convainquit qu’il devait se mettre en sécurité pour témoigner. Sa signature écrite en large caractères apparait au sommet de la déclaration d’Indépendance publiée quatorze mois plus tard, avec celles de Samuel et John Adams.
Le général Gage fut généralement blâmé en Grande-Bretagne pour avoir ouvert les hostilités, lui qui avait au contraire mis en garde contre leur probabilité, et avait monté l’opération de Lexington et Concord pour s’en prémunir. Le député libéral Edmund Burke, partageant les griefs des Américains contre le Parlement, souligna au contraire que Gage avait été naturellement peu enclin à réprimer ses compatriotes.
Pour les Américains, l’affrontement à Lexington et à Concord prit une importante part légendaire pour alimenter leur cause politique, et de très nombreux témoignages, y compris une déposition sous serment du capitaine John Parker attestant n’avoir pas tiré le premier, fut recueillie. Dans la confusion, Paul Revere avait été relâché par les Britanniques et magnifia le rôle qu’il avait joué. Au début du XIXème siècle, le poète Ralph Waldo Emerson, dont le grand-père, ardent patriote, avait habité une maison à deux pas du North Bridge de Concord et était un témoin oculaire de la bataille, composa des hymnes qui glorifièrent et la chevauchée de Revere et la bataille de Concord. En 1875, le centenaire de la bataille fut marqué par l’inauguration, en présence du président Ulysses S. Grant, de la statue du Minuteman de Concord, saisissant son fusil d’une main et lâchant sa charrue de l’autre, qui est encore aujourd’hui l’emblème de la Garde Nationale des Etats-Unis, celle des citoyens-soldats. Quatre de ses unités au Massachusetts, les 181ème et 182ème d’Infanterie, le 101ème bataillon du génie, et la 125ème compagnie de logistique, font remonter leurs origines aux milices villageoises qui prirent part aux combats de Lexington et Concord.
Ce détour dans l’histoire paraitra, notamment au regard de l’actualité du monde, comme une sorte de digression. On y voit pourtant des leçons intéressantes sur la façon dont les conflits éclatent. D’abord, on peut constater que les protagonistes d’un conflit sont en mesure de le voir arriver, en mesurant les tensions et en prenant les mesures décisives. On remarque aussi que l’éclatement des hostilités tient parfois de l’accident de circonstances, comme ce fut manifestement le cas à Lexington, et il s’en faut de peu pour que l’histoire se déroule autrement, ou que le conflit n’éclate en une autre occasion. En réfléchissant aux tensions du monde actuel, en particulier aux décisions tactiques et militaires prises par les diverses parties de différents conflits, les faits de Lexington et Concord sont parfois un troublant reflet de ce qui se passe aujourd’hui.